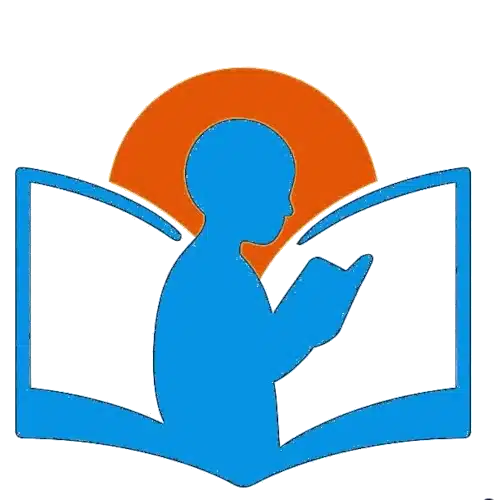Quel est le meilleur point de vue narratif pour votre histoire ? C’est une question que se posent tous les auteurs ou presque au moment d’écrire leur roman. Et c’est une question fondamentale. En effet, choisir le point de vue narratif va influencer :
- la manière dont vous écrivez votre roman ;
- la structure du récit (1 ou plusieurs points de vue) ;
- la stylistique de votre roman ;
- la manière dont le lecteur percevra votre œuvre ;
- etc.
Bref, beaucoup d’éléments de votre narration dépendent de ce choix-là. Il s’agit donc de ne pas se louper, tout en étant capable de relativiser : quelle que soit votre décision, vous devrez faire face à des contraintes plus ou moins fortes. En effet, il n’y a pas un point de vue meilleur qu’un autre.
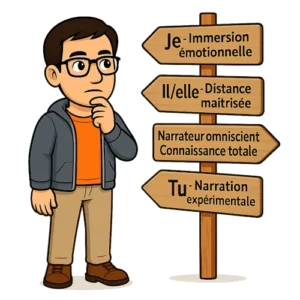
Qu’est-ce qu’un point de vue narratif ?
Définition
En narratologie, la perspective narrative (autrement appelé focalisation ou point de vue) correspond au prisme par lequel votre récit est narré. De manière plus simple, cela consiste à se demander :
- qui va raconter votre histoire ?
- qui sera votre ou vos narrateurs ?
- quel(les) voix votre lecteur va-t-il entendre ?
En effet, c’est l’une des grosses spécificités de la littérature. À ma connaissance, un roman ne peut pas exister sans narrateur. Quelqu’un doit raconter l’histoire. Dans les films ou pièces de théâtre, le spectateur peut juste assister à la représentation. Personne ne dit à l’audience ce qui va se passer ; elle le voit par elle-même. En revanche, en littérature (ou lorsque quelqu’un vous raconte ce qui est arrivé à sa grande tante Marthe un beau jour d’avril), vous devez passer par un médium (des mots ou la personne qui vous raconte ses péripéties) pour accéder à l’histoire. Et ces mots (ou ces paroles), c’est le romancier qui les a couchés sur le papier. Le lecteur dépend donc du bon vouloir de l’écrivain, qui va lui-même utiliser un narrateur.
On distingue plusieurs types de narrateur :
- le narrateur personnage ;
- le narrateur omniscient (il sait tout sur tout) ;
- et le narrateur externe (il vous raconte le film avec son vocabulaire à lui).
Choisir un point de vue narratif revient donc à s’interroger sur l’angle par lequel l’histoire sera racontée au lecteur.
Les types de point de vue narratif
À ma connaissance, l’utilisation des points de vue narratifs reste à peu près la même, peu importe le pays. Il m’a néanmoins semblé intéressant de réaliser un petit topo sur les différences de classification entre Anglo-saxons et Francophones.
Pourquoi ? Tout simplement parce que chacune des traditions permet d’aborder la notion de point de vue narratif de manière complémentaire. En effet, cela aide à prendre conscience des différentes perspectives offertes par chaque point de vue narratif. De cette manière, il est possible de mieux saisir certaines subtilités, comme le point de vue externe.
| Point de vue interne | Point de vue externe | Point de vue omniscient | |
| Je | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tu | ✅ | ❌ | ❌ |
| Il | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nous | ✅ ? | ❌ | ❌ |
| Vous | ✅ (forme de politesse du tu) | ❌ | ❌ |
| Ils | ❌ | ✅ | ✅ |
Le point de vue narratif à l’anglo-saxonne
Les pays anglophones ont davantage une approche par pronom. C’est-à-dire : je, tu, il, nous, vous, ils. Je ne crois pas en avoir oublié un. 🙂
Narration à la première personne
Le pronom « je » implique un point de vue subjectif. C’est comme si vous installiez une caméra dans le crâne de votre protagoniste. Vous avez accès à ce qui se passe dans son cerveau, aux pensées du personnage, mais aussi tout ce qu’il voit et perçoit.
« Je rentrai la voiture dans le garage. Alors que je manœuvrais à la lumière clignotante des néons, je manquai d’écraser un vélo qui traînait sur le côté. J’appuyai sur les freins juste avant de transformer le truc en tas de ferraille inutilisable. Encore un coup de Junior ! Quand est-ce qu’il apprendrait à ranger ses affaires, celui-là ?
Je me passai la main dans les cheveux. Foutu journée. Quand est-ce qu’elle se terminerait ? Et dire que je devais encore promener le chien. Vivement que je m’étale sur le canapé pour dégommer ma bière. Cependant, au moment où j’ouvris la porte du véhicule, j’aperçus Georgette qui me scrutait avec son regard de mégère, l’épaule appuyée contre la porte du garage. »
Parmi les récits célèbres romans à la première personne, on trouve par exemple L’Étranger de Camus. Parmi les écrits à la première personne, on trouve aussi les autobiographie, même si à proprement parlé il ne s’agit pas de fiction. Historiquement parlant, l’utilisation de la première personne a été longtemps réservée à certains types de récits (journaux intimes, etc.). Mais depuis quelque temps déjà, les romanciers utilisent la première personne pour tous les types de récits.
Narration à la troisième personne
Le pronom « il » est quant à lui ambivalent.
Il peut s’agir de ce que les Anglo-saxons appellent la « troisième personne limitée », c’est-à-dire un mode de narration identique à celui de la première personne (le « je »). La seule différence, c’est que l’histoire est racontée en « il ».
« Raymond rentra la voiture dans le garage. Alors qu’il tournait le volant, il remarqua le vélo de son fils qui traînait sur le côté. Il appuya sur les freins au dernier moment pour éviter la catastrophe. »
Cependant, une narration à la troisième personne peut aussi marquer la présence d’un narrateur omniscient. À la différence de la troisième personne limitée, le narrateur omniscient sait tout sur tout. Plus encore, il peut prendre n’importe quel angle de vue et adopter le ton de son choix.
« Raymond, la quarantaine bien tassée avec son ventre à bière et ses cheveux grisonnants, rentra la voiture dans le garage. La pièce était sombre, mal éclairée par les néons qui clignotaient. Il faut dire que le type gagnait à peine assez d’argent pour payer sa facture d’électricité. Alors, changer les néons, ce n’était pas la priorité du moment.
Raymond freina au dernier moment pour éviter d’aplatir le vélo que son fils avait abandonné une heure plus tôt sur le côté du garage avant de courir regarder les dessins animés. »
Cette classification induit un certain flou quant à la profondeur du point de vue en « il ». C’est pourquoi, je pense, on voit fleurir des concepts comme « deep point of view ». Et c’est pour cette raison, à mon avis, que cette classification est complémentaire à la classification française.
Les autres modes de narration
Les « tu », « nous », « vous » et « ils » sont des points de vue narratifs qui sont très peu utilisés.
Le « tu » et le « vous » ont pour objectif d’impliquer le lecteur dans la narration. On trouve par exemple les livres dont vous êtes le héros.
Certains auteurs, par exemple Karine Renneberg avec Meute, ont utilisé la deuxième personne comme s’il s’agissait de la première personne. Cependant, ce n’est pas un choix narratif encore très répandu parmi les écrivains.
« Tu choisis de garer la voiture dans le garage ».
Le « nous » et « ils » sont davantage utilisés pour marquer un mouvement collectif, quand l’individualité n’a plus vraiment sa place dans l’action. Raconter un roman entier à l’une de ces 2 personnes, ce n’est pas quelque chose que l’on rencontre très souvent en littérature.

Le point de vue narratif : la classification à la française
Les Francophones se focalisent davantage sur l’angle de vue, plutôt que sur la personne qui raconte.
Le point de vue interne
La focalisation interne rassemble deux points de vue narratif à l’anglo-saxonne :
- la première personne,
- et à la troisième personne limitée.
Le lecteur a accès à tout ce qu’il se passe dans la tête du narrateur, tout ce qu’il voit. Le lecteur a donc une vision interne de l’intrigue. En revanche, le personnage (et donc le lecteur) ignore tout ce que pensent les autres personnages ou ce qu’ils perçoivent. Avec ce type de focalisation, le lecteur découvre l’histoire au même moment que le personnage narrateur.
La distance entre le lecteur et le narrateur est donc très réduite. À ce titre, la focalisation interne est idéale pour créer de la proximité entre le lecteur et le personnage principal de votre roman. Je la recommande particulièrement si vous avez besoin de rendre votre protagoniste attachant ou si vous souhaitez que le lecteur comprenne très bien les processus mentaux du protagoniste. Cette perspective narrative facilite aussi l’identification au personnage.
En revanche, le point de vue interne vous obligera à un travail d’écriture très soigné pour bien rentrer dans la peau du personnage et retranscrire sa subjectivité au travers de ses mots et de ses syntaxes. C’est d’autant plus vrai si vous avez plusieurs personnages point de vue dans votre roman.
Une autre grosse difficulté à prendre en considération, c’est la gestion de l’information. En effet, le lecteur ne peut pas en savoir plus que le personnage (à l’exception des points de vue multiples). En conséquence, il vous faudra être très inventif pour amener l’information au lecteur si celle-ci se déroule hors de la portée du personnage.
Le point de vue externe
Dans ce type de point de vue narratif, le narrateur raconte l’histoire à la troisième personne. Plus encore, il ne décrit que ce qu’il perçoit par ses 5 sens. Il n’a donc pas accès à ce qui se passe dans la tête des personnages. C’est le point de vue du spectateur.
C’est comme si quelqu’un vous décrivait un film image par image, en ajoutant les odeurs, etc. La seule différence, c’est que le narrateur va s’exprimer avec ses propres mots, et ce faisant il va introduire un certain biais de narration.
En point de vue externe, le narrateur n’émet pas de jugements sur , c’est-à-dire qu’il ne s’implique pas dans l’histoire et ne donne jamais son avis.
Parmi les livres célèbres en narration externe, on trouve Moderato Cantabile de Marguerite Duras.
À titre personnel, j’ai très rarement lu des récits écrit en focalisation externe. Je me souviens d’une nouvelle que j’ai bêta-lue et dont l’auteur avait choisi ce point de vue narratif. La nouvelle en elle-même était très bien exécutée (la tonalité humoristique était brillante). Cependant, il était compliqué de s’attacher aux personnages et de comprendre pour quelles raisons ils se comportaient de cette manière. C’est à mon sens un problème dont vous devez être conscient si vous choisissez cette focalisation-là.
Paradoxalement, regarder un film permet aussi de s’interroger sur le comportement des personnages. Mais pourquoi Raymond et Georgette ne règlent-ils pas leurs problèmes une bonne fois pour toutes ? En tant que spectateur, vous interprétez leurs comportements, leurs paroles. Cela va susciter votre intérêt et votre curiosité. Cela va vous pousser à vous impliquer dans le récit pour combler les blancs.
Un autre très grand avantage de ce point de vue narratif-là, c’est qu’il vous donne la possibilité de décrire les scènes selon l’angle qui vous fait le plus plaisir. Vous pouvez également conserver une écriture constante.
Le point de vue omniscient
Le point de vue omniscient, comme dit plus haut, correspond à un narrateur qui sait tout sur tout. Il sait ce que chacun des personnages éprouve ou pense. Il est capable de prendre n’importe quel angle de vue lorsqu’il réalise des descriptions. Plus important encore, il connaît le passé, le présent et le futur.
Le point de vue omniscient aide le lecteur à obtenir une vision globale de l’histoire. Il a aussi pour avantage de créer du contraste, de l’ironie et de la nuance. Pourquoi ? Tout simplement parce que le lecteur en sait davantage que les personnages. Il sait que Georgette a acheté de la mort au rat et qu’elle pense depuis 15 jours à en a mettre dans la bière de Raymond. Et le lecteur, il a peur pour Raymond. Ce point de vue narratif-là permet aussi d’introduire de nombreuses informations de contexte, ce qui peut se révéler très utile si l’auteur exécute bien les choses.
En revanche, le point de vue omniscient peut rendre les personnages moins mystérieux, surprenants ou crédibles, car le lecteur connaît tout d’eux. De plus, il est plus difficile de créer de l’empathie, de l’identification, de la complicité, entre le lecteur et les personnages avec cette focalisation-là.
Utiliser un point de vue narratif

L’importance de la constance
J’aime bien prendre l’image d’une carte de géographie. Si la légende de la carte est mal respectée, alors l’ensemble paraîtra un peu bigarré, étrange. Cependant, les géographes font de petites exceptions : ils brisent par exemple les échelles lorsqu’ils incluent la Corse ou les DOM-TOM autour d’une carte de France. Pour cela, ils ont recours à des marqueurs visuels.

Il en est de même avec les points de vue narratifs. Pour faciliter la lecture d’un roman, il est très fortement recommandé de conserver le même type de focalisation tout au long du récit. Si vous changez de narrateur (par exemple, vous passez d’un narrateur à un autre au milieu d’un chapitre), il est recommandé de matérialiser le changement par un saut de ligne ou un symbole.
L’erreur que je vois souvent en bêta-lecture : un point de vue narratif flottant
Ce que j’appelle point de vue narratif flottant, c’est le fait que le point de vue narratif oscille très souvent entre point de vue interne, point de vue externe et point de vue omniscient alors que l’auteur souhaite écrire en point de vue interne.
Imaginons par exemple Raymond et Georgette. Vous avez choisi de leur donner à chacun un point de vue interne. Raymond et Georgette se rencontrent devant la porte du garage.
À titre personnel, je vous recommanderais de bien séparer les points de vue pour maximiser l’immersion et la compréhension de votre lecteur. Au minimum, un retour à la ligne avec le prénom du narrateur qui arrive dès le premier mot ou presque pour matérialiser le changement. Faute de quoi, vous perdrez en lisibilité pour le lecteur.
Par exemple :
« Raymond observa Georgette qui l’attendait à l’entrée du garage. Rien qu’aux rides qui creusaient son front et ses yeux plissés, Raymond comprit qu’il passerait encore un sale quart d’heure. La mégère s’était encore levée du pied gauche.
Georgette secoua la tête. Raymond avait deux grosses taches de graisse sur sa chemise. Qui allait les nettoyer, ces taches ? La Belle au Bois Dormant ? Non, à bien y réfléchir, elle était plutôt Cendrillon ! »
Accéder aux pensées des autres personnages en narration interne est impossible. Et c’est malheureusement une erreur que je trouve très souvent en bêta-lecture. De la même manière, si vous êtes en narration interne, il n’est pas possible de passer à un narrateur omniscient sans crier gare.
En revanche, dans le cas d’une narration omnisciente, il vous serait tout à fait possible de passer d’un personnage à un autre.
Par exemple :
« Raymond et Georgette se défièrent mutuellement du regard, chacun d’eux remâchant dans sa tête les griefs qui s’accumulaient depuis leur mariage, vingt ans plus tôt. Raymond voulait juste la paix après sa journée de travail. Se dégommer une bière et à la rigueur promener le chien. De son côté, Georgette en avait marre de tout faire à la maison en plus de son travail à plein temps. Il croyait quoi, le Raymond, que la popote et le ménage, cela se faisait tout seul ? ».
Vous avez besoin d’une bêta-lecture professionnelle pour votre roman ?
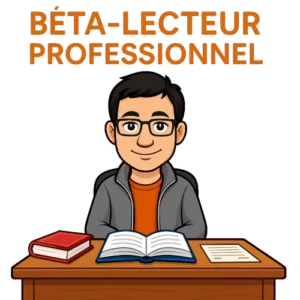
Consulter les prestations de bêta-lecture du Manuscrit Orphelin !
Tout n’est pas figé dans le marbre
À partir du moment où vous brisez certaines règles, vous perdrez en lisibilité pour le lecteur. Et celui-ci aura donc une moins bonne expérience de lecture.
Ceci dit, il est encore possible d’innover en matière de point de vue narratif. Par exemple, dans un polar que j’ai lu il y a longtemps, le prologue et l’épilogue étaient écris à la première personne. En revanche, le corps du roman, avec toujours la même narratrice, était écrit à la troisième personne en point de vue interne. De la même manière, il y a 20 ou 25 ans, il était inscrit dans le marbre ou presque que les récits à la première personne concernait uniquement les journaux intimes et autres autobiographies. Ce n’est désormais plus du tout le cas.
On trouve également des choix narratifs de plus en plus intéressants. Par exemple : un narrateur en « je » et un narrateur en « il » dans le même livre. J’ai parlé de Meute un peu plus tôt et sa narration en « tu ». Etc.
Pour moi, à partir du moment où l’histoire justifie le procédé, alors cela peut passer (mais cela ne plaira pas à tous les lecteurs, et il faut en être conscient).
Enfin, il me semble important de préciser que ces règles sont généralement brisées par des personnes qui les maîtrisent. Il y a une grande différence entre innover et ne tout simplement pas savoir comment gérer un point de vue narratif. Si vous en êtes à vos débuts, je vous conseille de rester sur des sentiers battus. Quand vous maîtriserez mieux les choses, alors vous pourrez expérimenter.
Choisir votre point de vue narratif
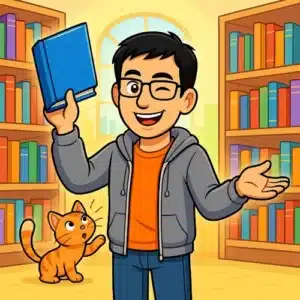
Chaque point de vue narratif a ses avantages et ses inconvénients. Chaque point de vue narratif façonnera le texte d’une certaine manière. Il n’existe pas de point de vue narratif idéal. En revanche, en déterminant le type de roman que vous souhaitez écrire, vous arriverez à déblayer le terrain. Et pour ce faire, un auteur peut se poser certaines questions
Avez-vous besoin que le lecteur prenne de la distance vis-à-vis des personnages et du récit ?
Je pense notamment à tous les récits comiques. L’effet comique est le résultat de la démesure, de l’exagération, etc. Une comédie est rarement réaliste. Plus encore, certains affirment qu’on écrit une tragédie sur un sujet avant de pouvoir écrire une comédie sur le même sujet.
En conséquence, si vous écrivez une comédie, il sera peut-être plus difficile d’utiliser le point de vue interne. Car il faut que le lecteur prenne du recul sur les événements. Une chute de 3 mètres dans une tragédie n’a pas les mêmes répercussions que dans une comédie.
Avez-vous besoin que le lecteur soit au même niveau que les personnages ? Qu’ils vivent les mêmes émotions qu’eux ?
C’est le cas pour les romans d’aventures, thrillers ou enquêtes policières. Si le cœur de la tension narrative est lié aux émotions de vos personnages, à leur état d’esprit ou à leur compréhension imparfaite de la situation, alors le point de vue interne est pour moi le plus indiqué.
Je pense ainsi à un livre que j’ai écrit. Il s’agissait d’une tragédie où j’avais très à cœur de faire vivre au lecteur le même drame psychologique que mon protagoniste. J’ai donc choisi un point de vue interne en « je ». Ce choix permet au lecteur de partager la souffrance du personnage, mais il le laisse parfois dans l’impossibilité de comprendre les choses en profondeur. Pourquoi ? Parce que le personnage lui-même en est incapable. Le lecteur doit donc deviner.
J’aurais sans nul doute opté pour un point de vue omniscient si au lieu de faire vivre ce drame, j’avais désiré que le lecteur comprenne les origines et les mécanismes psychiques qui avait mené mon personnage à la dépression.
Quel est votre style d’écriture favori ?
Selon Orson Scott Card, certains auteurs ont un style poétique très reconnaissable qu’ils ne parviennent jamais vraiment à moduler en fonction de leurs personnages. Dans une telle situation, utiliser un point de vue interne se révèle parfois compliqué (ou alors il faut trouver le personnage qui s’y prête).
Comment est-ce que vous sentez les choses ?
Cela peut paraître bête, mais parfois il faut savoir le faire à l’instinct. Si pour une raison ou une autre, vous trouvez que cela fonctionne mieux avec tel ou tel point de vue, alors il faut y aller. Et surtout, je conseille de tester plusieurs choses pour voir ce qui vous convient le mieux.
Quelle est la forme de votre manuscrit ?
J’ai écrit plusieurs manuscrits où je n’avais tout simplement pas le choix en termes de point de vue narratif. Le premier était un journal intime, le second un témoignage oral enregistré par un ordinateur. À chaque fois, le personnage s’exprimait en son nom propre. Le point de vue interne en « je » était donc inévitable.
Dans le même genre, un roman épistolaire ne vous laissera aucune marge de manœuvre.
Quelle est la complexité de l’histoire ?
Si vous avez seulement un protagoniste en point de vue interne, mais que votre histoire est très complexe, vous risquez d’avoir des difficultés à retranscrire au lecteur tous les tenants et les aboutissements de votre récit.
Certes, vous avez toujours la possibilité d’ajouter 2 ou 3 personnages point de vue supplémentaires. Cependant, plus vous multipliez les points de vue, plus cela demande de la virtuosité au niveau de l’écriture.
Conclusion
Le point de vue narratif influence beaucoup de choses dans un roman. Il faut donc le choisir avec soin, en fonction de ses objectifs, de ses envies, de ses besoins. C’est pourquoi il est important de connaître les différents points de vue, leurs caractéristiques et de se poser certaines questions, tout en étant capable de suivre son instinct.
Cependant, si la maîtrise de votre focalisation narrative fait parfois la différence entre un bon roman et un roman moyen, la perspective narrative reste un outil parmi d’autres. En effet, le choix du temps du récit a également un vrai impact sur le récit.
Cet article vous plaît ? Envie d’en savoir plus ?

Inscrivez-vous à la newsletter du Manuscrit Orphelin !